Fort de plus de trente ans d’expérience en santé publique, l’infirmier et professeur d’université Roberto Martins de Souza transforme son expérience en recherche dans l’ouvrage « Tuberculose et ses représentations dans la société », fruit de sa thèse de doctorat à la PUC-SP. Cet ouvrage analyse non seulement les effets physiques de la maladie, mais aussi les conséquences émotionnelles et sociales auxquelles sont confrontés les patients, qui, malgré les progrès de la médecine, vivent encore dans la stigmatisation et l’exclusion.
S’appuyant sur des entretiens et une recherche bibliographique approfondie, l’auteur révèle comment la tuberculose continue de provoquer isolement et discrimination, notamment chez les personnes vivant avec le VIH. Pour Souza, le problème dépasse le champ médical : il reflète un modèle de soins qui marginalise encore les patients. « La maladie crée une rupture entre le corps et l’esprit, et il est nécessaire d’y remédier dans le cadre du traitement », souligne-t-il.
Plus qu’une étude académique, cet ouvrage invite à une réflexion sur l’empathie, l’inclusion et l’humanisation des soins. Roberto Martins de Souza est professeur d’université à São Paulo, capitale et dans les zones rurales, et possède une vaste expérience des hôpitaux et des unités de soins primaires. « Tuberculosis and its Represents in Society » marque ses débuts en tant qu’auteur, alliant expérience pratique et rigueur scientifique dans un ouvrage essentiel pour les professionnels de santé et tous ceux qui s’intéressent aux relations entre médecine, esprit et société.
Tout au long de votre carrière d’infirmière et de professeure, quel a été le moment le plus marquant qui a éveillé en vous le besoin de transformer la tuberculose en sujet de recherche et, maintenant, en livre ?
Ce qui a déclenché mon désir de faire de la tuberculose un sujet de recherche, et maintenant un livre, c’est la prise de conscience de la nécessité de développer des campagnes gouvernementales, que ce soit à la radio, à la télévision, dans les journaux ou par d’autres moyens de diffusion d’informations sur la tuberculose.
Le nombre de cas de tuberculose augmente chaque année, ici au Brésil comme dans d’autres pays. J’ai vu le nombre de patients que je vois doubler chaque semaine. La tuberculose est une maladie étroitement liée à la pauvreté, et nous constatons que la pauvreté progresse également dans le monde entier. La rédaction du livre « La tuberculose et ses représentations dans la société » vise à sensibiliser le public à la tuberculose.
Vous analysez les effets de la tuberculose non seulement sur le corps, mais aussi sur l’esprit et la vie sociale des patients. Selon vous, laquelle de ces dimensions est la plus négligée par le système de santé ?
Je pense que ces deux aspects sont négligés par le gouvernement. Nous avons de nombreux professionnels de santé dans les grands centres urbains, comme les régions du Sud-Est, du Centre-Ouest et du Sud, mais très peu dans les régions du Nord et du Nord-Est. Je pense que si le gouvernement investissait davantage de ressources dans ces régions moins favorisées, les taux de tuberculose atteindraient des niveaux acceptables.
La tuberculose affecte le corps et l’esprit, précisément à cause de l’appauvrissement de la population, en particulier ici au Brésil, où le chômage augmente à un rythme alarmant et, par conséquent, génère la pauvreté.
Pour une personne atteinte de tuberculose pulmonaire, le traitement approprié dure environ six mois. Le patient reste alors isolé socialement, par crainte de transmettre la maladie.
Les préjugés accompagnent toujours la tuberculose, comme autrefois dans les sanatoriums. Qu’est-ce qui vous a le plus surpris en entendant les témoignages de patients victimes de discrimination aujourd’hui ?
La discrimination persiste, mais dans une moindre mesure que par le passé. Les patients atteints de tuberculose pulmonaire ou pleurale sont pris en charge dans une unité de soins de base (USB) pendant six mois. La transmission étant respiratoire, ces patients ont peur de parler, de tousser et même de partager des objets personnels tels que fourchettes, couteaux, serviettes, etc.
Après les quinze premiers jours de traitement, grâce à l’utilisation d’antibiotiques spécifiques, ce patient ne transmet plus le bacille de la tuberculose. Cependant, certains membres de sa famille, voire son lieu de travail, peuvent l’exclure de la vie sociale. Ceci est injustifié.
Comment percevez-vous le lien entre la tuberculose et le VIH, qui accentue souvent la stigmatisation ? Y a-t-il des mesures que vous jugez essentielles pour que cette association ne soit plus une source d’exclusion ?
La tuberculose associée au VIH engendre une stigmatisation importante dans la société et parmi les familles de certains patients. Je crois que plus nous parlerons de ces deux maladies au plus grand nombre, moins cette stigmatisation sera importante, même si je ne pense pas que ces préjugés disparaîtront complètement. Il est essentiel de sensibiliser le public à ces deux maladies.
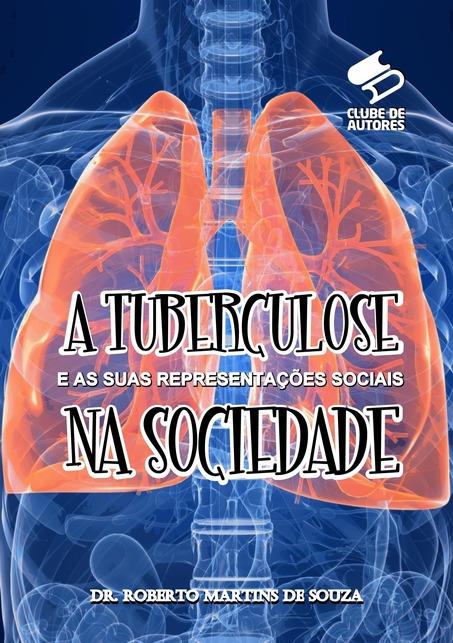
Au cours de vos recherches, vous avez constaté que les patients traversent un processus de « reconfiguration de vie » face à la maladie. Quelles histoires vous ont le plus marqué à ce sujet ?
Plusieurs témoignages intéressants ont été recueillis : dès le début du traitement contre la tuberculose, les patients constatent, en deux semaines, une diminution des symptômes, notamment de la fièvre et de la toux. Grâce à une alimentation saine, leur poids a déjà augmenté. C’est une grande satisfaction pour les patients comme pour les professionnels qui les soignent.
Votre livre souligne également le rôle des réseaux sociaux et de la communication dans le renforcement – ou la lutte – des préjugés. Selon vous, comment pouvons-nous utiliser ces canaux pour promouvoir davantage d’empathie et d’inclusion ?
Les réseaux sociaux sont extrêmement importants, car ils permettent à la société de se tenir informée de l’actualité. Les gens ont besoin d’informations de toutes sortes, et je crois que seule l’information permettra de réduire l’incidence de nombreuses autres maladies, et pas seulement la tuberculose et le VIH.
Vous avez travaillé de nombreuses années dans des hôpitaux, des unités de soins primaires et des universités. Comment cette expérience pratique a-t-elle contribué à ce que ce livre dépasse la théorie académique et devienne un portrait humain de la maladie ?
Après avoir travaillé avec des patients atteints de tuberculose pendant plusieurs années et enseigné dans plusieurs universités, j’ai décidé d’écrire l’ouvrage « La tuberculose et ses représentations sociales » non seulement à destination des étudiants de premier cycle et des professionnels de santé, mais aussi du grand public. L’ouvrage est quasiment dépourvu de terminologie technique, ce qui le rend accessible à tous.
Qu’espérez-vous que les lecteurs retiennent de ce livre : une conscience sociale, une réflexion philosophique sur la santé et l’exclusion, ou un défi de transformer la façon dont nous traitons les patients ?
J’espère tout cela, car au fil de leur lecture, les lecteurs en apprendront davantage sur la maladie, ses modes de transmission, son diagnostic et son traitement. C’est un défi pour la société de ne pas considérer uniquement le patient lui-même, mais une personne, un être humain.
Suivez Roberto Martins de Souza sur Instagram

