Face à la présence croissante du christianisme dans le débat public, le linguiste et chercheur postdoctoral Lucas Nascimento a publié *Le Poison du langage : Le défi évangélique de dire la vérité sans blesser* (Editora Mundo Cristão), un ouvrage qui questionne l’usage irresponsable du langage par les chefs religieux. S’appuyant sur des épisodes de discours de haine, de xénophobie et d’intolérance, l’auteur propose une communication éthique guidée par le respect, la justice et la sensibilité aux contextes de vulnérabilité – des principes qui, selon lui, devraient guider tout discours chrétien.
Dans votre livre, vous réfléchissez au contraste entre le discours chrétien et les déclarations souvent blessantes. Comment voyez-vous cette contradiction se reproduire dans les églises aujourd’hui ? Et qu’est-ce qui vous a amené à aborder ce sujet si directement ?
Malheureusement, l’histoire des Églises chrétiennes est pleine de contradictions, et certaines deviennent parfois plus évidentes. Actuellement, le discours public de nombreux chrétiens au Brésil témoigne davantage d’arrogance et de jugement moralisateur que de proclamation de l’Évangile du Royaume. Nombreux sont ceux qui confondent la proclamation de l’Évangile avec la propagation d’un moralisme évangélique motivé par des idéologies moralistes et politiques. À mon avis, cela est contraire à l’esprit de ce que Jésus nous a enseigné et révèle que de nombreux chrétiens n’aiment même pas leurs coreligionnaires, et encore moins leurs « ennemis ».
J’étudie le discours religieux évangélique depuis plus de 15 ans et, depuis quelque temps, j’observe que des frères et sœurs prennent plaisir à parler pour blesser et humilier au nom de Dieu. Voyant cette situation s’aggraver, j’ai décidé d’étudier comment de telles choses se produisent, afin de mieux comprendre le phénomène et de proposer un chemin de sagesse à ceux qui le souhaitent.
L’expression « poison de la langue » est puissante et porte une grande charge symbolique. Pourquoi avez-vous choisi ce titre et comment pensez-vous qu’il suscite une nécessaire introspection chez les lecteurs chrétiens ?
La métaphore de la langue venimeuse est riche, et le demi-frère de Jésus, dans sa lettre, l’utilise pour démontrer le pouvoir maléfique d’une communication perverse. Il dit : la langue « est incontrôlable et méchante, pleine d’un venin mortel » (Jacques 3:7). En choisissant ce titre, je pense à une source de sagesse, de vie et de paix à laquelle les chrétiens peuvent puiser dans leur communication. Loin de cette source, la langue du croyant peut aussi devenir un poison mortel, surtout si le cœur de celui qui l’utilise est rempli d’une « envie amère et d’une ambition égoïste ».
Comme je le dis dans le livre, les chrétiens doivent comprendre et réfléchir au fait que leur communication peut être source de vie, mais aussi de mort. Et, malheureusement, c’est ce qui s’est produit ces dernières années au Brésil chez de nombreux évangéliques et institutions chrétiennes.
Dans votre livre, vous proposez l’idée de « présomption d’humiliation » comme critère éthique pour évaluer l’impact d’un discours. Comment imaginez-vous que ce concept puisse être intégré au quotidien de ceux qui souhaitent communiquer avec plus d’empathie et de responsabilité ?
La notion de « présomption d’humiliation », que j’emprunte au philosophe israélien Avishai Margalit invite à une sensibilité éthique dans l’usage du langage, notamment dans les contextes asymétriques. En adoptant ce critère, nous proposons que, face au doute, le bénéfice de l’interprétation soit accordé à ceux qui ont historiquement été les plus exposés à la souffrance symbolique, comme les minorités et les groupes vulnérables comme les personnes LGBTI+, les personnes noires, les sans-abri, les autochtones et bien d’autres. Cela ne signifie pas renoncer à ce que l’on croit être vrai ou à la critique, mais reconnaître que toute critique n’est pas juste simplement parce qu’elle est vraie.
Au quotidien, cette perspective peut être mise en pratique par de petits changements : se demander, avant de parler : « Si j’étais à la place de l’autre, comment recevrais-je ce discours ? » ou « Ce que je vais dire est-il nécessaire, édifiant et empreinte de miséricorde ? » Jésus nous appelle à la vérité, mais à une vérité tempérée par la grâce. Incarner ce critère est donc un exercice constant d’empathie, de maîtrise de soi et de peur ; non pas la peur de l’autre, mais le respect du fait que chaque être humain est à l’image de Dieu et mérite d’être traité avec dignité, même en cas de désaccord.
Vous évoquez des cas de discours de haine et de stigmatisation de groupes vulnérables par des chefs religieux. Comment réagissez-vous face à ceux qui invoquent la foi pour justifier des propos offensants, prétendant simplement « dire la vérité » ?
Les êtres humains ont tendance à fuir leurs responsabilités. Souvent, la science, l’État, les lois, et surtout Dieu ou les Écritures, servent d’échappatoires, servant à dissimuler de mauvaises intentions ou à justifier la pratique de l’iniquité envers autrui. Malheureusement, de nombreux chrétiens parlent au nom de Dieu, mais expriment davantage de ressentiment et de vanité que de compassion et de vérité. Ils prétendent « ne dire que la vérité », alors qu’en réalité, ils pratiquent une forme de justice qui n’a rien à voir avec l’Évangile.
Le théologien allemand Dietrich Bonhoeffer , assassiné par Hitler au siècle dernier, y était profondément sensible. Il nous mettait en garde contre les dangers de ce qu’il appelait la « demi-vérité » – celle qui se présente comme pure et objective, mais qui ignore le contexte et la relation. Pour lui, il existe une différence éthique entre le contenu de la vérité et l’acte de la dire. Ceux qui disent « la vérité » froidement, sans sensibilité et hors contexte déshonorent la vérité qu’ils prétendent porter. Bonhoeffer affirme même que ceux qui s’obstinent à parler sans relâche et de manière égale à tous, sans tenir compte de la relation, du moment ou de la condition humaine, sont plus proches du cynique que du prophète. Une telle personne se sent « comme un Dieu au-dessus des créatures faibles » et détruit « la vérité vivante parmi les hommes ».
La vérité de l’Évangile est toujours incarnée, imprégnée de miséricorde. Le Christ qui a dit « Je suis la vérité » est aussi celui qui a pardonné à l’adultère, pleuré avec les endeuillés et touché les intouchables et les démunis de son temps. Un discours chrétien qui ne se laisse pas influencer par cette miséricorde risque simplement d’utiliser le nom de Dieu pour perpétuer le privilège, la peur et la haine – ce qui, au fond, est une forme perverse d’idolâtrie. Bien que je n’adhère pas à la notion de discours de haine, je peux affirmer que la haine a été le sentiment qui caractérise les discours de nombreux frères et sœurs évangéliques. Sommes-nous reconnus par l’amour ?
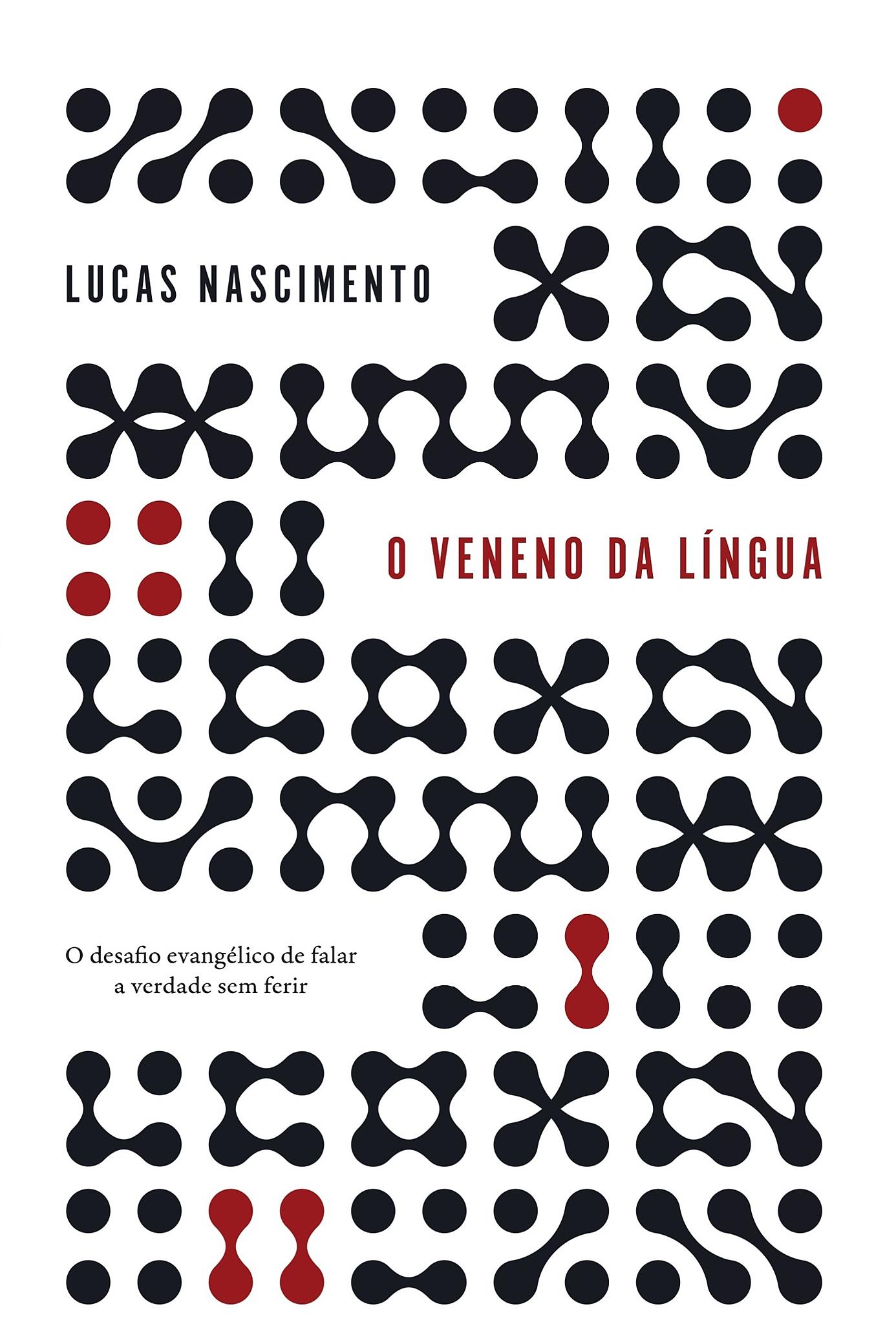
Parmi les compétences que vous proposez, l’écoute de différents points de vue avant de se forger une opinion figure en tête de liste. Selon vous, pourquoi l’écoute est-elle devenue un tel défi à l’ère de la polarisation et de la communication instantanée ?
Aujourd’hui, les gens ont tendance à n’entendre que l’écho de leur propre voix religieuse, idéologique ou politique, plutôt que celle des autres. Il en va de même chez les évangéliques. Les réseaux sociaux ont amplifié ce phénomène, que les experts appellent « bulles de filtrage » ou « chambres d’écho ». La loi de la tribu, de mon groupe, de mon idéologie ou de ma théologie a prévalu. Une controverse virulente a régné. Il n’y a aucune volonté d’écouter véritablement ceux qui sont différents, et encore moins ceux qui sont en désaccord. C’est un problème grave, car il exacerbe encore les divisions et l’incompréhension.
La compréhension consiste à entrer dans le monde de l’autre, à l’écouter, à ressentir ce qu’il ressent, puis à le quitter et à revenir à soi-même. De là naît la compréhension. Cependant, pour un esprit polarisé, ce mouvement est impossible. Il regarde l’autre de l’extérieur, sans véritable écoute, sans empathie. Cela génère des malentendus et creuse encore davantage le fossé entre les personnes. Mais cela ne devrait pas être l’attitude du chrétien. Nous sommes appelés à entrer dans le monde de l’autre, comme le Christ l’a fait lorsqu’il est entré dans le nôtre. Mais cela exige humilité, volonté de servir et amour. Une communication sage ne peut se faire sans humilité et amour de l’autre, et donc sans écoute.
Votre travail allie linguistique et spiritualité de manière très singulière. Comment votre livre a-t-il été accueilli dans les milieux universitaires et évangéliques ? Sentez-vous qu’il existe une ouverture à ce dialogue ?
C’est une ouverture intéressante. Lorsque j’aborde ce sujet lors de conférences ou de cours à l’université, mes collègues universitaires sont très intéressés, car ils n’ont pas une compréhension claire de ce qui se passe dans la sphère publique avec la présence des évangéliques.
Nombre d’entre eux ne connaissent pas les recherches sur les évangéliques.
Dans les milieux évangéliques, je ressens encore les effets de cette relation entre éthique discursive et spiritualité. Si j’ai reçu un accueil chaleureux et bienveillant dans certains milieux chrétiens, j’ai aussi constaté de la méfiance et des réticences chez d’autres. Mais il est encore trop tôt pour tirer des conclusions (rires). L’important est de répondre à l’appel à proclamer.
Parler clairement, adapter son ton et choisir ses mots avec discernement sont des compétences qui semblent simples, mais qui requièrent une grande prudence. Au cours de votre carrière d’enseignant et de chercheur, qu’avez-vous appris sur le pouvoir – et le danger – des mots mal placés ?
Les mots n’ont aucun pouvoir en eux-mêmes. Leur pouvoir provient d’un ensemble de facteurs discursifs (subjectifs, sociaux et institutionnels). Ensemble, ces facteurs peuvent créer des empires, comme cela a été le cas pour les grands empires au fil des siècles, mais ils peuvent aussi les détruire encore plus rapidement. Au-delà de leurs éléments spirituels spécifiques, les religions sont des constructions symboliques, produites dans et par le langage.
J’aime parler des gros mots. Ce double sens renvoie au fait qu’une mauvaise communication peut déclencher des guerres, détruire des royaumes et semer le chaos chez les individus, les groupes et les institutions. Les annulations sur les réseaux sociaux en sont une petite preuve.
Développer la capacité de connaître la raison derrière ce qui est dit, quoi dire, comment le dire et quand le dire au bon moment, avec sagesse, est fondamental pour que les mots ne soient pas seulement des mots, mais de bonnes actions.
Vous invitez les lecteurs à s’engager dans un langage qui reflète l’amour, la justice et la sagesse. À ceux qui souhaitent amorcer cette transformation dans leur façon de communiquer, quelle serait la première étape que vous recommanderiez ?
La première étape peut consister à prendre conscience de l’importance du langage dans la vie. Nous pouvons y parvenir en examinant trois dimensions.
Premièrement, nous devons comprendre que les mots ne sont pas que des mots. Ce sont des actions concrètes. Par eux, nous bénissons ou maudissons, guérissons ou blessons, donnons la vie ou créons la mort. Par la parole, le monde a été créé ; et au cœur de la foi chrétienne se trouve le Verbe fait chair. Parler, c’est donc agir ; et nos paroles peuvent (et doivent) être de bonnes œuvres, comme nous l’enseigne Jacques 3.
Deuxièmement, nous devons reconnaître que chaque mot a un impact. Parfois, une phrase qui nous semble simple peut rouvrir de vieilles blessures, renforcer un traumatisme ou humilier silencieusement. D’autres fois, une oreille attentive ou un compliment sincère peuvent réconforter quelqu’un, comme le dit Salomon : « Les paroles aimables sont comme le miel, douces pour l’âme et salutaires pour le corps. » Les mots ont un pouvoir thérapeutique ou destructeur, et cette prise de conscience transforme notre façon de communiquer et d’aimer.
Enfin, il est important de considérer la motivation derrière nos paroles ou nos silences. Comme je l’écris dans ce livre, nos paroles peuvent avoir au moins trois origines : la stratégie, lorsque nous parlons pour obtenir des résultats ; la conséquence, lorsque nous parlons par impulsion ou par peur ; ou la vertu, lorsque nous parlons par intégrité et par amour. Demandez-vous : pourquoi est-ce que je dis cela ? Quel désir me pousse à le faire ?
À partir de cette triple conscience, l’étape suivante consiste à cultiver les vertus de la parole. Développer un langage qui reflète le Royaume de Dieu : juste, aimant et pacifique. Un langage à la fois vrai et empreint de grâce.
Suivez Lucas Nascimento sur Instagram

